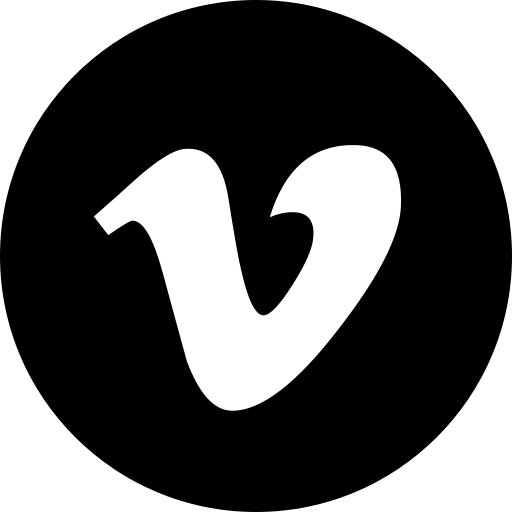Dans le domaine musical et musicologique, on a l’habitude d’appeler classicisme la période comprise entre la fin de l’époque baroque et le début de l’époque romantique ; grosso modo, entre la mort de Bach (1750) et les premières manifestations d’attitudes romantiques dans la civilisation allemande-autrichienne : par exemple, les Lieder de Schubert ou Der Freichütz (1821) de Karl Maria von Weber, prototype de l’opéra romantique allemand. Un compositeur clef de la période classique est Franz Joseph Haydn (1732-1809), lequel amena à pleine maturité la forme-sonate et les genres musicaux tels la sonate pianistique, le quatuor et la symphonie. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) et le jeune Beethoven (jusqu’au début du nouveau siècle) sont les autres grands compositeurs de cette période. Ceci dit, classicisme et romantisme en termes de musique sont des catégories esthétiques, et donc des constructions intellectuelles très (trop) génériques qui risquent de limiter l’interprétation de la réalité artistique, des langages et des styles musicaux. Si dans l’œuvre des compositeurs de la période classique on peut envisager des attitudes pré-romantiques, dans les œuvres des compositeurs romantiques on peut repérer des attitudes classiques. Par exemple, Chopin, féru de l’œuvre de Johann Sebastian Bach, et réputé comme compositeur romantique, n’a écrit que des œuvres de musique « absolue » évitant de donner à ses compositions des titres renvoyant aux catégories poétiques du romantisme. La musique de Brahms, face à celle de Wagner, fut longtemps considérée comme néo-classique et ceci avant l’heure, notamment en raison de la préférence du compositeur pour les genres instrumentaux de la musique « absolue ». Cependant, le style musical de Brahms est caractérisé par des élans passionnels et pathétiques typiques de la tradition romantique. En outre, Brahms fut également très influencé par Schumann, compositeur romantique par excellence. Cependant sa musique contient les germes d’un modernisme reconnu bien plus tard, lorsque Schönberg, en 1947, écrivit le célèbre article « Brahms le progressif ».
Les catégories esthétiques exprimant le Zeitgeist d’une époque risquent d’être trop génériques pour interpréter la complexité et la spécificité des langages artistiques, des styles, des œuvres. Il en va ainsi pour la catégorie du néo-classicisme en musique. La Deuxième Guerre mondiale stimula une opposition entre la culture germanique et la culture des pays latins. Dans le domaine musical elle se manifesta comme un refus de la tendance romantique et des tendances modernistes reliées au romantisme tardif ; comme un « retour à l’ordre », aux principes et aux modèles d’une culture « classique » dans un sens très large comprenant ainsi la tradition baroque. Retour à l’ordre, à la clarté du soleil et aux mythes de la culture méditerranéenne s’opposant aux tendances artistiques et aux mythes de la culture germanique ayant mené à une dissolution des principes de la culture classique.
Stravinsky composa la musique du ballet Pulcinella (1919-1920) en orchestrant à sa façon plusieurs pièces attribuées à Pergolèse. À partir de ce moment, il fut considéré comme chef de file du mouvement néo-classique. Or, même s’il partageait certains principes du néo-classicisme, sa poétique et son style demeurent très personnels par rapport aux autres compositeurs qui, après la Deuxième Guerre mondiale, « étaient retournés à l’ordre ». Lorsque Stravinsky composa Pulcinella, les tendances esthétiques et artistiques qui furent à l’origine du néo-classicisme musical apparaissaient d’une façon encore confuse en Europe. Busoni offrit un des premiers témoignages de l’apparition de ce mouvement dans une lettre à son fils, dans laquelle il se plaignait d’avoir été mal compris. Au début de l’année 1920 en effet, il avait publié dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, sous le titre « Junge Klassizität », une lettre à Paul Bekker ; et voilà qu’on le qualifiait de « partisan du nouveau classicisme », c’est-à-dire de « quelque chose qui était lié au passé », alors que dans sa lettre à Bekker, il avait voulu avec ce terme exprimer « la maîtrise, le choix et la mise en valeur de tout ce que les expériences précédentes avaient permis d’acquérir, et les préserver dans des formes solides et belles [1] ».
C’est là le premier maillon d’une longue chaîne de malentendus, d’équivoques et de quiproquos engendrés par l’indétermination sémantique du terme néo-classicisme. Ces malentendus n’étaient pas encore imputables à des raisons idéologiques, qu’elles soient plus ou moins avouées. Cependant, bien avant l’histoire des tendances et des traits stylistiques qui peuvent être qualifiés de néo-classiques, l’histoire du néo-classicisme est l’histoire d’une idée, d’un principe esthétique et des différentes interprétations qui en découlent. Ceux qui, comme Casella, espéraient que la musique italienne se serait transformée en « une sorte de classicisme qui aurait pu harmoniser les très belles innovations italiennes et étrangères [2] », inaugurant ainsi une saison néo-classique, considéraient le néo-classicisme d’une façon progressiste. Cela correspondait à certaines tendances esthétiques du fascisme avant le rétrécissement idéologique des années trente, celle par exemple qui considérait « la fusion entre tradition et modernisme [3] » comme un moyen pour atteindre la perfection artistique en Italie. Schönberg, lui, se moqua de Stravinsky et du néo-classicisme au travers de ses cantates satiriques Vielseitigkeit et Der neue Klassizismus. Lorsqu’il consacra à ce sujet une réflexion critique, il plaça ce courant parmi les tendances qui mortifient « l’idée » musicale et suivent un style de façon frénétique et insensée [4].
Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu’aux années soixante, la thèse adornienne qui opposait d’une manière manichéenne Schönberg et Stravinsky, l’un champion du progressisme, l’autre de la restauration, fut l’interprétation esthétique du néo-classicisme la plus suivie [5]. Boulez en revanche, en rapprochant la dodécaphonie de Schönberg — avec ses structures formelles héritées du passé — du néo-classicisme de Stravinsky, envisagea une conciliation entre ces deux tendances diamétralement opposées qu’il jugeait aussi régressives et restauratrices l’une que l’autre [6], estimant par ailleurs que l’individualité stylistique de chaque compositeur était de toute façon sauvegardée par le caractère spécifique de son langage. Que ce soit dans le milieu des critiques ou dans celui des musicologues, cette conciliation entre les deux tendances, une fois dépouillée des flèches polémiques de Boulez, s’est enfin affirmée. Dans la vie, comme dans l’histoire, le temps affaiblit les contrastes.
Cependant Alan Lessem, musicologue anglais naturalisé canadien, souligne dans un important article sur ce sujet que « les différences entre les deux compositeurs sont remarquables, et le néo-classicisme, loin de les concilier, permit au contraire de les examiner plus à fond [7] ». Quoi qu’il en soit, Stravinsky lui-même, dans ses dialogues avec Robert Craft semble souscrire à une interprétation conciliante. En effet, il affirme, à propos des tendances de l’avant-garde musicale avant et après la Première Guerre mondiale, que sa période de formulation arriva seulement à la fin des années vingt, lorsque le soi-disant « néo-classicisme » s’affirma : le « néo-classicisme de Schönberg, de Hindemith, et le mien [8] ». Il s’agit d’une des très rares fois où Stravinsky emploie le terme néo-classicisme d’une façon explicite, et comme à chaque fois qu’il y a recours, il se sent tenu de l’expliquer. Ainsi, dans un article paru en décembre 1927 dans The Dominant, il tient à préciser que le néo-classicisme, selon lui, n’est pas simplement « une imitation du langage soi-disant classique », mais une récupération de la « substance formelle » en tant que « base unique de la musique [9] ». De plus, il prend presque toujours une distance ironique avec le terme, lui adjoignant l’adjectif « soi-disant » — ce qui le décharge d’une responsabilité personnelle — ou des remarques amusantes, comme lorsqu’il parle de son aptitude à composer de la musique « pas du tout désagréable », sans avoir la conscience d’être en train de faire du néo-classique. En deux occasions, Stravinsky affirme que certaines prémices du « soi-disant néo-classicisme » existaient plusieurs années avant Pulcinella, qui ne fit que marquer l’explosion d’un conglomérat détonant de tendances déjà sous-jacentes.
Je jouai la Polka en présence de Diaghilev et d’Alfredo Casella dans une chambre d’hôtel à Milan, en 1915, et je me souviens de leur surprise à tous deux, étonnés que le compositeur du Sacre du printemps eût créé une telle pièce de popcorn. Mais un nouveau chemin s’était ouvert à Casella, et il s’y engouffra bientôt ; une sorte de soi-disant néo-classicisme naquit à ce moment-là [10].
Malgré la trace évidente de Petrouchka que l’on trouve dans Eccentric, il me semble que ces Trois pièces préfigurent les Pièces faciles pour piano à quatre mains de l’année suivante, et mon « néo-classicisme » si aberrant avec lequel, sans savoir de quoi il s’agissait, j’ai réussi à composer de la musique pas du tout désagréable [11].
Même en faisant abstraction des a priori idéologiques et en tenant compte seulement des résultats musicaux et artistiques, il est très difficile de définir exactement le néo-classicisme musical, qui ne fut pas, loin s’en faut, un mouvement homogène et unitaire, mais plutôt la somme de tendances et de styles divers : chaque créateur et chaque nation ayant mis en évidence des aspects différents de cette tendance esthétique, des multiples poétiques en résultèrent, liées entre elles par des rapports d’affinité. Une autre difficulté découle de la substance esthétique même du néo-classicisme. D’abord utilisé par d’autres disciplines artistiques, le terme implique des relations symboliques qui s’appliquent plus ou moins aux manifestations musicales.
Pour tisser la toile des relations, des différences, des échanges entre tous les membres de « l’Internationale néo-classique » sur une période d’une trentaine d’années il faudrait lui consacrer un livre, voire plusieurs. Il est nécessaire d’établir un critère permettant de distinguer ce qui est néo-classique de ce qui ne l’est pas, ou de ce qui n’est néo-classique qu’en surface. Pour être valable, ce critère doit évidemment faire abstraction des différences de style, d’attitude, de manière, et s’appliquer à la seule essence du néo-classicisme.
Le rapport avec le passé, avec le « classique » dans le sens de « ce qui précède le romantisme », est le point capital de la poétique néo-classique. Il s’agit donc de distinguer la différence entre la façon dont le néo-classicisme reprend le passé et celle dont les compositeurs du XIXe siècle abordent ce passé. Dans ce dernier cas, l’assimilation stylistique du passé est rectiligne : une conscience historique évolutionniste absorbe, assimile, incorpore le style ancien dans le style contemporain. C’est le cas, par exemple de Brahms, même si on a vu qu’on ne peut pas réduire son style, son langage, à cette seule catégorie esthétique. Dans le cas du néo-classicisme du XXe siècle, au contraire, une rupture plus ou moins profonde sépare le présent d’un passé choisi afin qu’il soit recréé. Le passé est alors récupéré dans une situation de fracture intentionnelle offrant une confrontation dialectique entre le style contemporain et le style ancien. On pourrait ainsi distinguer une récupération évolutionniste de l’histoire et une récupération dialectique de l’histoire. À la lumière de ce principe, il convient maintenant d’analyser les principales tendances musicales annonciatrices du néo-classicisme, apparues pendant et juste après la Première Guerre mondiale.
– Évocation d’une saison « classique » conçue comme âge mythique de pureté et de transparence linguistique, comme Le Tombeau de Couperin de Ravel (1914-1917).
– Déformation ironico-grotesque de la tradition comme dans la Sonatine bureaucratique (1917) de Satie ou la Polka des Trois Pièces faciles pour piano à quatre mains (1914-1915) de Stravinsky, que le compositeur qualifie lui-même d’« un certain type de soi-disant néo-classicisme ».
– « Restauration » d’une œuvre ancienne orchestrée et réadaptée au goût moderne comme Le Astuzie femminili de Cimarosa, révisées par Respighi en 1920.
– Parodie dans le sens de l’imitation d’une tradition classique, comme la Symphonie classique (1917) de Prokofiev.
– Pastiches-collages de pièces d’un ou de plusieurs compositeurs anciens pour créer des suites symphoniques comme les Antiche danze ed arie per liuto de Respighi (première suite en 1917) ou des ballets comme Les Femmes de bonne humeur (1917) de Scarlatti-Tommasini, La Boutique fantasque (1919) de Rossini-Pergolèse et Pulcinella (1919-1920) de Pergolèse-Stravinsky.
Chacune de ces tendances établit un rapport différent entre style et modèles. Dans le premier cas, si l’on peut considérer le modèle qui a inspiré Ravel comme tout à fait néo-classique (âge d’or du clavecin français, style et caractéristiques du langage musical de l’époque ; clarté, linéarité, absence de développements amples et drama-tiques, etc.), le style ravélien absorbe presque tout le passé dans le présent. Il n’y a donc pas véritablement fracture, mais plutôt continuité et assimilation rectiligne.
La fracture en revanche est irréparable dans le cas de la déformation ironico-grotesque, comme si le modèle du passé avait été mis entre guillemets. Ce genre de fracture était particulièrement chère à tous ceux qui voulaient mettre en évidence ce qu’une telle fracture sous-entendait d’idéologie anti-bourgeoise ; c’est le cas de la Sonatine bureaucratique de Satie, dont le commentaire ironique souligne encore la parodie satirique de la Sonatine de Clementi.
La troisième tendance correspond à ce que l’on entend couramment par « transcription ». Comme dans le domaine de l’art plastique, pictural ou architectural, il s’agit d’une restauration musicale qui permet à une œuvre du passé d’être jouée et appréciée par des auditeurs modernes. Selon l’intention du « restaurateur », la fissure entre le passé et le présent peut être plus ou moins profonde. Elle est sans nul doute peu profonde dans le cas des « restaurations » de Respighi, si on les compare à une édition critique d’aujourd’hui réalisée selon des principes musicologiques rigoureux : d’un côté, une sorte d’historicisme visant à suturer les blessures et à moderniser le passé, de l’autre, une philologie qui tente, au contraire, de récupérer le passé de la façon la plus fidèle possible, sans vertige aucun face à une fracture historique expressément conservée.
Quant aux deux dernières tendances, elles sont le champ d’action préféré du néo-classicisme naissant : le calquage parodique, le pastiche et le collage stimulent cette confrontation dialectique entre les époques et les styles, laquelle à son tour crée la fracture historique, dans la mesure, bien entendu, où il y a volonté expresse de la créer. Nous allons tenter de vérifier ce point à la lumière de la série des ballets-pastiches pro-duits par Diaghilev juste après la Première Guerre mondiale, série à laquelle appartient Pulcinella.
À part quelques manipulations effectuées pour des raisons scéniques et théâtrales ou pour relier les différents morceaux les uns aux autres, Tommasini et Respighi ont fidèlement conservé dans Les Femmes de bonne humeur et La Boutique fantasque les traits mélodiques, harmoniques et rythmiques originaux de leur modèle respectif. L’orchestration est donc le seul élément qui nous permette de vérifier le sens de l’opération « néo-classique ».
Dans le cas des Femmes de bonne humeur, Massine et Diaghilev avaient choisi parmi les sonates de Scarlatti — après avoir engagé un pianiste qui leur joua presque toutes les sonates du compositeur — celles qui s’adaptaient le mieux au sujet du ballet tiré de la comédie homonyme de Goldoni.
Tommasini, de son côté, s’appuya sur l’édition de Longo qu’il respecta, à peu d’exceptions près, en répétant d’une façon automatique dans son orchestration certaines symétries du langage de Scarlatti. Ce traitement peut être considéré comme une transcription, une « restauration ». Par endroits, l’orchestration amplifie des traits saillants du langage scarlattien [12] : par exemple, la couleur espagnole dans la scène X du dîner, où le pizzicato des cordes sur le premier accent de la mesure et la réponse des bois mettent en relief l’allure de « zapateado » de la section tonale de la Sonate L 14 ; ou bien encore l’ostinato de la section tonale de la Sonate L 474, souligné par l’accompagnement des cuivres. Le traitement de la section tonale de la Sonate L 203 est un autre exemple de mise en relief du modèle folklorique : en situant sur scène un trio de deux flûtes et guitare, Tommasini, en accord avec l’action théâtrale (la sérénade du comte Rinaldo, scène II) transforme la sonate en une sérénade languide. De la même manière, en réduisant l’ensemble orchestral (quintette de cordes), la sonorité (emploi des sourdines) et le mouvement (andante au lieu de l’andante mosso indiqué par Longo), Tommasini s’empare de l’esprit de la Sonate L 33 : une méditation liturgique apte à l’élévation pour l’a solo de Costanza dans la scène XVIII.
Mais comment interpréter ces cas où, au lieu d’une simple transcription, certains traits du texte original sont mis en évidence à tel point qu’ils se détachent du contexte ? S’agit-il d’un début d’éloignement vis-à-vis du modèle ? Ou plutôt d’une simple mise en relief réalisée pour des raisons scénographiques ? La difficulté de répondre nettement à cette interrogation nous fait prendre conscience du fait que nous sommes en présence d’une phase de transition, où certaines solutions commencent à être entrevues.
Ces problèmes de classement ne se posent pas dans le cas de La Boutique fantasque. Respighi lui-même montra à Diaghilev les sources musicales qui pouvaient être utilisées, c’est-à-dire la Musique de piano, Œuvres posthumes de Rossini publiée par Heugel, qui contenait la série complète des Quelques riens. La Boutique fantasque reprend le sujet d’un autre ballet de la fin du XIXe siècle (Die Puppenfee de Hassreiter, sur une musique de Joseph Bayer), les poupées vivantes renvoyant plutôt à Coppélia. L’action se passe à Naples vers 1860, même si Diaghilev, qui pour le décor s’était d’abord mis en rapport avec Bakst avant de passer la commande à Derain, disait que la toile de fond rappelait bien plus un restaurant des bords du lac de Genève qu’un magasin de jouets devant le golfe de Naples. Comme dans le cas des Femmes de bonne humeur, l’action scénique est synchronisée avec les sources musicales. L’orchestration de Respighi, elle aussi, est synchronisée avec la seconde moitié du XIXe siècle — rappelons que Les Péchés de vieillesse ont été composés pendant les années 1860 — mais en un sens plus tchaïkovskien que rossinien. Au lieu de s’emparer et de mettre en relief les sous-entendus ironiques des Péchés de vieillesse, qui préfiguraient Satie, le traitement de Respighi habille les thèmes de vêtements sonores voyants qui font penser à Rimsky-Korsakov, Tchaïkovsky et Delibes. Aussi son remaniement est-il non seulement non néo-classique, mais aussi anti-néo-classique, car il annule les fractures ouvertes par un Rossini pré-classique, assurant une continuité historique rectiligne due par une absorption stylistique totale.
Parmi ces « ballets rétrospectives », Pulcinella demeure un cas exceptionnel qui mérite d’être analysé de manière plus détaillée. Le 15 mai 1920, trois mois après la création du Chant du rossignol à l’Opéra, Diaghilev présente au public parisien un nouveau ballet-parodie basé sur la musique italienne du passé, cette fois-ci à partir de différents extraits d’œuvres composées par — ou attribuées à — Pergolèse : Pulcinella, signé par Massine, chorégraphe et protagoniste, Picasso, qui l’année précédente, en 1919, avait conçu rideau, décors et costumes pour Le Tricorne de Manuel de Falla, et Stravinsky, chargé d’orchestrer les extraits d’œuvres de Pergolèse, vrais et faux.
Tous les moyens que Stravinsky emploie dans Pulcinella pour attirer dans l’orbite de son style personnel le style baroque-napolitain de Pergolèse amènent au même résultat : la transformation d’un langage correspondant à une conception artistique conséquente et symétrique en un autre langage, gouverné, tout au contraire, par le sens de la fragmentation et de la discontinuité. De ce conflit entre le modèle et la copie est né le « style néo-classique » de Stravinsky lequel a tant bouleversé les critiques de l’époque qui s’attendaient, tout comme Diaghilev dans un premier temps, à une « orchestration élégante » de Pergolèse façon Tommasini. Stravinsky affirme :
J’étais tout à fait conscient que je n’aurais pas produit une « contrefaçon » de Pergolèse, étant donné que mes habitudes propulsives sont très différentes ; j’aurais pu, éventuellement, répéter Pergolèse avec mon accent personnel. Il était presque inévitable que le résultat assumerait un sens satirique (qui aurait pu traiter ce matériau-ci en 1919 sans en faire une satire ?). Mais aussi cette observation me vient a posteriori et je commençai à travailler sans intention satirique aucune. Diaghilev, d’ailleurs, n’aurait pu concevoir une telle possibilité. Il ne voulait rien d’autre qu’une orchestration élégante, et ma musique le choqua tellement que pendant quelque temps il eut l’air d’un dix-huitième siècle offensé [13].
Plusieurs critiques exprimèrent leur perplexité face à l’obstination et à la démesure du résultat, à la vulgarité et à la lourdeur de plusieurs sonorités. Mais il y en eut d’autres pour lesquelles la parodie stravinskienne était quelque chose de beaucoup plus complexe et raffinée qu’une simple contrefaçon cocasse ou une musique « à la manière de ». Louis Laloy affirmait que « la musique de M. Stravinsky était classique » comme celle de Pergolèse, « mais bien moderne, ou, pour mieux dire, bien personnelle », met-tant en évidence l’originalité absolue de l’orchestration. Reynaldo Hahn aussi avait été étonné par les « diableries géniales » de l’orchestration dont Stravinsky « est seul ca-pable », et avec beaucoup de finesse parlait du style harmonique du compositeur et de ses qualités acoustiques. En outre, il aborda le sujet de la relation stylistique et poétique entre le présent et le passé avec beaucoup d’humour, attribuant à une « femme éminente et charmante » la distinction entre le « respect » et « l’amour » du passé dont Stravinsky se souviendra. Dans les Chroniques de ma vie, pour distinguer son néo-classicisme des différents « retours à » et « à la manière de » qui commencent alors à se propager en Europe jusqu’à devenir une mode culturelle, Stravinsky utilisa cette même comparaison métaphorique :
Pour aborder une tâche aussi ardue, je me trouvai dans la nécessité de répondre à la question la plus importante, qui fatalement se posait à moi dans cette circonstance. Se-rait-ce le respect ou mon amour pour la musique de Pergolèse qui devait dominer dans ma ligne de conduite à son égard ? Est-ce le respect ou l’amour qui nous pousse à la possession de la femme ? N’est-ce pas uniquement par l’amour qu’on arrive à pénétrer l’essence d’un être ? Et puis, l’amour diminue-t-il le respect ? Seulement, le respect de-meure toujours stérile et ne peut jamais servir d’élément producteur et créateur. Pour créer, il faut une dynamique, un moteur, et quel moteur est plus puissant que l’amour ? Aussi, pour moi, poser la question, c’était la résoudre [14].
Avant que Stravinsky ne prenne conscience du fait que Pulcinella représente l’acte de naissance du néo-classicisme (ou, plutôt, de son néo-classicisme à lui) cette œuvre fut donc un travail d’orchestration très spécial, conçu dans le cadre d’un projet théâtral précis. Si l’on veut comprendre le rôle fondamental que le style de Stravinsky et sa conception dramaturgique jouèrent à ce moment crucial de sa carrière, ainsi que les étapes successives de son évolution stylistique, il est essentiel de garder cela à l’esprit.
« Pulcinella fut le chant du cygne des années passées en Suisse [15] », affirmait-il dans Expositions and Developments. Pulcinella était d’abord l’occasion de présenter au public international de la métropole française la nouvelle conception sonore et orchestrale expérimentée pendant la guerre dans des œuvres comme Renard et Les Noces, qui n’avaient pas encore été représentés, ou avaient eu, comme L’Histoire du soldat, une diffusion très limitée à cause de la guerre.
Une interview accordée à André Rigaud, et publiée en 1920 dans le numéro de mai de la revue Comœdia, témoigne de ce que Stravinsky voulait justement mettre en évidence cet aspect de son « style nouveau » :
C’est une musique d’un genre nouveau, une musique simple avec une conception orchestrale différente de mes autres œuvres. Et cette nouveauté réside en ceci : les « effets » musicaux sont d’ordinaire obtenus par la juxtaposition des nuances ; un piano succédant à un forte produit un « effet ». Mais c’est là chose conventionnelle et convenue. J’ai tâché d’atteindre à un dynamisme égal dans la juxtaposition des timbres des instruments qui sont la base même de la matière sonore. Une couleur ne vaut que par le rapport des autres couleurs qui lui sont juxtaposées. Le rouge n’a pas de valeur par lui-même, il ne l’acquiert que par le voisinage d’un autre rouge ou d’un vert, par exemple. C’est ce que j’ai voulu faire en musique et ce que je cherche tout d’abord, c’est la qualité du son. Je cherche aussi la vérité dans le déséquilibre des instruments au rebours de ce qu’on fait dans ce qu’on appelle la musique de chambre, dont la base même est un équi-libre convenu entre les divers instruments. Et cela est tout à fait nouveau, personne ne l’a jamais essayé en musique. Ce sont des innovations qui surprennent parfois. Mais l’oreille devient peu à peu sensible à ces effets qui la choquent tout d’abord. Il y a toute une éducation musicale à entreprendre [16].
Il est évident que pareille conception sonore et orchestrale, déjà expérimentée par Stravinsky dans les œuvres théâtrales de la période suisse et appliquée ici pour la première fois au langage musical d’un auteur du passé, est très proche de la conception fauviste et cubiste, et donc de celle de Picasso. Depuis le début de l’année 1917, après leur rencontre à Rome où la compagnie de Diaghilev répétait Les Femmes de bonne humeur, le peintre et le musicien étaient devenus des amis très proches. Ils avaient des goûts communs et ce n’est pas par hasard si Diaghilev désapprouvait les productions artistiques autant de l’un que de l’autre. Après s’être vu refusé son projet de costumes « style Offenbach », Picasso se contenta de quelques indications de couleurs : pour les jeunes filles rose et vert, pour (les) Pulcinella et Pimpinella blanc et rose, pour les soupirants violine et bleu, pour les pères brun et noir. La seule maquette qu’il présenta fut celle du costume de Massine, blouse et pantalon blanc, bas rouge, demi-masque noir dans la pure tradition de la commedia dell’arte.
Cette variété chromatique, en différenciant les personnages selon leurs rôles, éclairait un argument tiré d’un sujet du théâtre populaire napolitain intitulé Les Quatre Polichinelles semblables. En même temps, elle apportait une touche de couleurs à une scène un peu sombre, l’action se déroulant à la lumière de la lune. Cependant, le contraste entre la toile de fond et les costumes des personnages troubla les critiques de l’époque autant que la musique de Stravinsky :
La même disproportion [entre la musique de Pergolèse et le traitement de Stravinsky] se retrouve entre le costume fanfreluché des danseuses ou des danseurs et le décor de M. Picasso. On voit que M. Picasso a voulu faire une toile de fond sur laquelle se détachent les personnages. Là encore, il aurait fallu éclairer la lanterne [17].
Cette intrigue, on le voit, est d’un entendement facile. Il n’en va pas de même du décor de M. Picasso qui est, lui, d’une limpide incompréhension ! Les costumes, de tonalités chatoyantes et d’un luxe raffiné, gagneraient à s’épanouir sous les flots plus éclatants de lumière. La scène a paru sombre. Une turbulente frénésie anime les danses réglées par M. Massine. Celles-ci — comme toujours — procèdent d’une excessive et curieuse fantaisie. Ni les yeux ni l’oreille ne se reposent un instant, sollicités sans cesse, de tous côtés, par des ensembles ou des détails amusants [18].
Au moment des répétitions de Pulcinella, la difficulté majeure fut la synchronisation et le juste équilibre entre les rythmes musicaux, les volumes sonores et les mouvements chorégraphiques. Massine, qui avait déjà signé les chorégraphies des Femmes de bonne humeur et de La Boutique fantasque, travailla tout d’abord sur des réductions pianistiques que le compositeur lui envoyait régulièrement de Morges. Le chorégraphe s’attendait à un certain type d’orchestration, mais lorsque Stravinsky vint assister aux répétitions à Paris, Massine comprit qu’il devait tout changer pour adapter la chorégraphie à l’échelle sonore de l’orchestre de chambre.
La surexcitation rythmique de la partition, autant que le sujet, incita Massine à donner à l’action chorégraphique le caractère d’une pièce frénétique de marionnettes, qui, par des gestes et des mouvements rapides, exprimaient une vaste gamme d’émotions. Plusieurs critiques nous révèlent dans quelle mesure cette frénésie était un des traits stylistiques saillants de la chorégraphie de Pulcinella. Jean Bastia, par exemple, écrit à ce sujet un compte-rendu plein d’humour :
Avant-hier soir, à l’Opéra j’ai assisté à la création de Pulcinella. Je n’avais aucun “argument” sous les yeux. J’ai vu des gens qui dansaient, qui tournaient, qui faisaient toutes sortes de manières qu’on n’est pas accoutumé de voir tous les jours, ils pirouettaient sur eux-mêmes, ils s’enlevaient en battant plusieurs fois l’air avec leurs pieds, puis ils sortaient. D’autres arrivaient, faisaient la même chose et sortaient. Et les premiers revenaient et faisaient la même chose, et les derniers, revenus aussi, faisaient de même avec eux. […] Cela m’a rappelé la petite chanson enfantine :
Elles font font font
Les petites marionnettes,
Trois petits tours... et s’en vont.
Les enfants n’en demandent pas davantage, cette explication leur suffit. Je crois que toute la danse n’est qu’une interprétation des “trois petits tours” des petites marionnettes — après quoi, toutes les danseuses et tous les danseurs s’en vont [19].
Comme dans le cas du classicisme et du romantisme, dans le cas du néo-classicisme, on ne peut pas réduire le style et le langage musical à une seule catégorie esthétique. Plus les compositeurs sont créatifs, plus le style englobe, absorbe, pour ainsi dire, les catégories esthétiques, les transformant en traits stylistiques. Bien évidemment c’est le cas de Stravinsky dont le soi-disant néo-classicisme fut une déclinaison de son style. Tandis que la plupart des critiques contemporaines interprétaient Pulcinella et les œuvres faisant référence à des modèles de la tradition occidentale comme une régression par rapport aux œuvres faisant référence à des modèles de la tradition russe, comme Le Sacre du printemps ou Petrouchka, il y a une continuité et une cohérence absolue du point de vue stylistique.
Il faut aussi tenir compte du fait que, pour Diaghilev ainsi que pour les compositeurs et les artistes qui collaboraient avec lui, la tendance néo-classique n’était pas du tout ressentie comme une tendance régressive. Et ceci pour plusieurs raisons.
Au cours des saisons des Ballets Russes, des ballets « rétrospectifs », conçus à partir de pièces musicales de compositeurs du passé comme Pulcinella sont souvent programmés en même temps que des ballets affichant leur modernité de manière plus ou moins « scandaleuse » (par exemple, en 1917, Les Femmes de bonne humeur et Parade). Cette coexistence d’ancien et de moderne ne dérive pas seulement de la stratégie théâtrale de Diaghilev, transformant ses spectacles en des vitrines de tendances diverses, dans l’esprit de la « mode », mais d’une conscience et d’une attitude esthétique pour lesquelles la relation entre arké et modernité ne répond pas aux critères de la tradition occidentale.
En Occident, au cours de la période comprise entre le début du siècle et la Première Guerre mondiale, le paradigme avant-gardiste s’affirme de manière de plus en plus ostensible. J’emploie ce terme dans le sens donné par Antoine Compagnon dans Les Cinq Paradoxes de la modernité [20] : avant-garde comme tension utopique vers le futur, qu’il faut distinguer du modernisme comme recherche du nouveau dans le présent (selon le célèbre précepte poétique de Baudelaire : « Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau ! »). En Russie, l’esthétique promue par Diaghilev et par Mir Iskousstva [Le Monde de l’Art] au cours de la première décennie du nouveau siècle consiste d’une part dans la récupération d’un passé caché et oublié (voir l’exposition des portraits en 1905 [21]), et de l’autre dans un dialogue et un échange avec l’art occidental selon le célèbre principe dostoïeskvien : « Nous Russes avons deux patries : la Russie et l’Europe ». D’où la hantise de l’histoire et de modèles historiques de la tradition occidentale en même temps que l’enfoncement, sollicité par les tendances néo-nationalistes, dans une arké russe remontant jusqu’aux sources les plus anciennes, mythiques et préhistoriques. Il est certain que les penchants des artistes russes de « l’âge d’argent » pour le symbolisme, le mysticisme et l’ésotérisme ont stimulé plusieurs artistes à « aller au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau », rejoignant le modernisme occidental. Or, le caractère propre à Mir Iskousstva correspond plutôt à la fascination des styles précieux, anciens et modernes, ainsi que la recherche d’une perfection formelle dans l’élaboration des œuvres. En 1908, Dmitri Filosofov, cousin de Diaghilev et maître à penser des adhérents au groupe créé par Diaghilev, écrivait dans la revue Zolotoe rouno [La Toison d’or] :
Pour comprendre, ne serait-ce qu’un tout petit peu Somon, Doboujinsky, Benois, Bakst, Lanceray, il faut connaître non seulement le XVIIIe siècle, mais aussi les années trente ; il faut consciemment piler dans un mortier Gainsborough et Beardsley, Levitski avec Brioulov, Vélasquez avec Manet, les xylographies allemandes du XVIe siècle et les eaux-fortes de Goya, les gravures du XVIIe siècle avec les lithographies de 1830, les dessins d’Orlowski avec ceux de Daumier. Ce n’est qu’après avoir avalé et digéré tout ce mélange que l’on saisit enfin, que l’on apprécie toutes les subtilités de nos artistes [22].
L’année suivante, le poète symboliste Andreï Biély qui avait adhéré au groupe après avoir visité l’exposition des peintres de Mir Iskousstva en 1902, écrivait à propos du même sujet :
Toute la force et le futur du soi-disant Art Nouveau dérive de l’impulsion à créer un rapport nouveau avec la réalité en ré-utilisant des figurations oubliées ; de là vient l’éclectisme particulier de notre époque ; je ne crois pas que Nietzsche avait raison de condamner durement la période alexandrine de la civilisation classique ; au contraire, cette époque, avec sa superposition de plusieurs courants de pensée et de conscience, aujourd’hui nous semble un moment très fort [23].
Malgré certaines affinités entre les courants occidentaux du symbolisme et de l’art nouveau, l’esthétique de Mir Iskousstva est plus semblable à un postmodernisme avant la lettre. Bien entendu, un post-modernisme qui s’engage à dépasser un des « grands récits » de la deuxième partie du XIXe siècle : à savoir, le réalisme des peredfvizniki [les Ambulants] attisant les haines et les reproches de « décadence » de tous le paladins de cette esthétique engagée (parmi lesquels Stasov et la mère de Filosofov, qui avait payé très cher son engagement personnel). Il est évident que cette fascination de l’arké (qu’elle soit « primitive » ou « alexandrine ») peut servir à expliquer les choix de Diaghilev et les programmes des Ballets russes (surtout jusqu’à la Première Guerre mondiale). Mais elle permet aussi de comprendre la persistance de l’amour du « Grand Siècle » et de sa mythologisation (du Pavillon d’Armide à Apollon musagète, en passant par La Belle au bois dormant) ainsi que le fil rouge liant les ballets « rétrospectifs » des premières saisons (Les Sylphides, Carnaval, Papillons) et les ballets « néo-classiques » produits entre la fin de la guerre et l’après-guerre (Les Femmes de bonne humeur, La Boutique fantasque, Pulcinella).
Cependant, donner trop de relief à la permanence de cette fascination de l’arké au cours de l’histoire des Ballets Russes à partir de la poétique de Mir Iskousstva serait une simplification historiographique. L’histoire des Ballets russes est une histoire complexe et discontinue (comme, du reste, toutes les histoires) à cause, d’une part, de l’hétérogénéité des composantes artistiques des ballets, d’autre part, des facteurs esthétiques, économiques, idéologiques, sociologiques, qui sont à l’origine de chaque ballet au cours des différentes périodes. En outre, il faut toujours tenir compte de la différence de perspective selon qu’on assume un point de vue occidental ou russe. Tout ce que je viens de dire et d’expliquer a pour but de prendre conscience que l’utilisation générique de la catégorie du néo-classicisme dans le domaine musical et musicologique, mais peut-être aussi dans les autres domaines artistiques, risque de devenir une « nuit où tous les chats sont gris », selon la célèbre boutade de Hegel commentée par Schelling. Métaphore particulièrement parlante : une idée abstraite, qui n’est pas développée dans sa signification concrète, ne se différencie pas, dans ce vide sémantique, d’une autre.
Gianfranco Vinay a été professeur d’histoire de la musique au Conservatoire Giuseppe Verdi de Turin. Il a participé, dès son arrivée à Paris en 1994, à la formation doctorale « Musique et musicologie du XXe siècle » Ircam/CNRS jusqu’en 1998. Entre 2003 et 2013, il a été maître de conférences HDR au département de musique à l’université de Paris 8 – Saint-Denis. Il a publié de nombreuses études sur la musique du XXe siècle.
[1] lettre de Ferrucio Busoni à Paul Bekker, 7 février 1920, Frankfurter Allgemeine Zeitung ; lettre de Busoni à son fils datée du 18 juin 1921.
[2] Alfredo Casella, janvier 1918, « La nuova musicalità italiana », in Ars Nova.
[3] Voir Fiamma Nicolodi, 1984, Musica e Musicisti nel ventennio fascista, Fiesole, p. 120 sq. et p. 235 sq.
[4] Voir Arnold Schönberg, 1950, Style and Idea, New York, Philosophical Library.
[Arnold Schönberg, 2002, [1977], Le Style et l’idée, trad. fr. Christiane de Lisle, Paris, Buchet-Chastel.]
[5] Voir Theodor W. Adorno, 1949, Philosophie der neuen Musik, Tubingue.
[Theodor W. Adorno, 1979, Philosophie de la nouvelle musique, trad. fr. Hans Hildenbrand et Alex Lindenberg, Paris Gallimard.]
[6] Voir Pierre Boulez, 1949, « Trajectoires : Ravel, Stravinsky, Schönberg », in Contrepoints, n° 6, (aussi dans Relevés d’apprenti, Paris, 1966) et, octobre 1971, « Style ou idée ? », dans Musique en jeu, n° 4, (aussi dans Points de repère, Paris, 1981).
[7] Alan Lessem, 1982, « Schoenberg, Stravinsky, and Neo-Classicism : The Issues Reexamined », The Musical Quarterly, n° 48, p. 527.
[8] Igor Stravinsky, Robert Craft, 1959, Memories and Commentaries, Londres, p. 122.
[Igor Stravinsky, Robert Craft, 1963, Souvenirs et commentaires, trad. fr. Francis Ledoux, Paris, Gallimard.]
[9] Eric Walter White, 1979, [1966], Stravinsky. The Composer and his Works, « Avertissement », Londres, Boston, p. 577.
[Eric Walter White, 1983, Stravinsky, le compositeur et son œuvre, trad. fr. Dennis Collins, Paris, Flammarion.]
[10] Igor Stravinsky, Robert Craft, 1982, Dialogues, Londres, p. 41.
[11] Voir Gianfranco Vinay, 1990, « Le sonate di Domenico Scarlatti nell’elaborazione creativa dei compositori italiani del Novecento », in Chigiana, vol XL, Florence, Olschki, p. 119-141 et, en ce qui concerne Les Femmes de bonne humeur, p. 121-126.
[12] Voir Gianfranco Vinay, 1990, « Le sonate di Domenico Scarlatti nell’elaborazione creativa dei compositori italiani del Novecento », in Chigiana, vol XL, Florence, Olschki, p. 119-141 et, en ce qui concerne Les Femmes de bonne humeur, p.121-126.
[13] Igor Stravinsky, Robert Craft, 1981, [1962], Expositions and Developments, 1981, [1962], Berkeley et Los Angeles, University of California Press, p. 112-113.
[14] Igor Stravinsky, 1935, Chroniques de ma vie, Paris, Denoël et Steele, première partie, p. 176-177.
[15] Igor Stravinsky, Robert Craft, Expositions and Developments, op. cit., p. 112.
[16] André Rigaud, mai 1920, « M. Igor Stravinsky nous parle de la musique de Pulcinella », Comœdia.
[17] Louis Schneider, 17 mai 1920, « Opéra – Ballets russes : Pulcinella, musique de M. Igor Strawinsky, d’après Pergolèse », Le Gaulois.
[18] Antoine Banès, 17 mai 1920, « Théâtre national de l’Opéra – Première représentation de Pulcinella, musique de Pergolèse et de M. Strawinski », Le Figaro.
[19] Jean Bastia, 17 mai 1920, compte-rendu de Pulcinella, Comœdia.
[20] Antoine Compagnon, 1990, Les Cinq Paradoxes de la modernité, Paris, Seuil.
[21] Exposition de « Portraits historiques russes de 1705 à 1905 » organisée par Diaghilev au Palais de Tauride de Saint-Pétersbourg. Elle marqua une date mémorable dans l’histoire de l’art russe.
[22] Dmitri Filosofov, 1908, Zolotoié rouno [La Toison d’or], n° 1, p. 73, cit. dans Jean-Claude Marcadé, 1995, L’Avant-garde russe, 1907-1927, Paris, Flammarion, p. 26.
[23] Andreï Biéli, 1910, Emblématika smysla, in Symvolysme, Moscou, cit. par Janet Kennedy ; 1984, « Mir Iskusstva e il concetto di stile », trad. par C. Cavagna, in Mir Iskusstva. La cultura figurativa, letteraria e musicale nel Simbolismo russo, Rome, Edizioni E/O, p. 21.