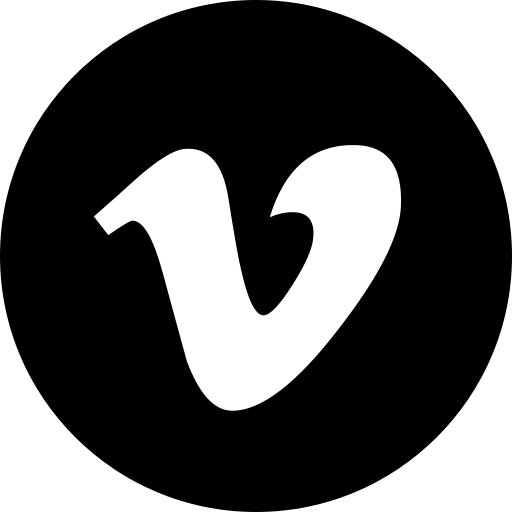Atys, présentation de la tragédie lyrique de Lully et Quinault par Thierry Leroux
Consulter la version pdf de ce texte
Tragédie lyrique en 5 actes précédés d’un prologue, de Lully et Quinault.
Inspiré des Fastes d’Ovide et créé le 10 janvier 1676 à Saint-Germain en Laye, avec 77 musiciens de l’Académie Royale de Musique, la Petite Bande, les Douze Grands Hautbois, la Chapelle royale et l’Écurie du Roy et les Vingt-quatre violons.
Atys est un songe. Sa destinée, faite de cette étoffe, était sans doute de plonger dans un profond sommeil - long de trois siècles- avant qu’enchanteurs et magiciennes ne viennent l’en tirer, par deux fois en moins de vingt-cinq ans, pour lui redonner une vie dont nos yeux, nos oreilles et tous nos sens ne peuvent oublier le charme.
Ils ont nom William Christie, les Arts Florissants, André Villégier, Patrice Cauchetier, Carlo Tommasi, et bien sûr Francine Lancelot et Béatrice Massin, ceux qui, avec tant d’écoute complice, ont entendu cette petite phrase, flottante dans les airs du temps :
« Mais, n’oublie pas,
Que la beauté,
Quand elle est immortelle,
Demande la fidélité
D’une amour éternelle… »
Défi de taille que cet appel, qui supposait de puissantes volontés et d’éminents talents pour être relevé. Ils les ont réunis, ont fait renaître Atys, et à travers lui tout l’art d’une époque qui intéresse un public sans cesse plus large et plus curieux.
DANS LES COULISSES DU TEMPS
A la création d’Atys, en 1676, Lully règne sur toutes les formes de théâtre musical associant la danse et le chant. Depuis quatre ans et la fin de sa collaboration avec Molière*, il marche avec Quinault vers la tragédie lyrique.
Dans Cadmus et Hermione en 1673, puis Alceste en 1674, où subsistent des restes de comique (d’ailleurs médiocrement goûté dans ce genre), la dimension tragique est encore peu marquée, même si la mort est présente. Avec Thésée, en 1675, elle s’affirme, les dieux et déesses s’y montrant d’assez redoutables personnages, très capables de manier le poison. On reste toutefois dans le registre du « divertissement » censé délasser le roi au retour de campagne.
En 1676, Louis XIV poursuit ses ambitions guerrières, mais cherche une quiétude nouvelle, qu’il trouvera à Marly plus qu’à Versailles. A la cour, les regrettables expériences de la marquise de Brinvilliers distillent une atmosphère délétère, que son exécution cette année-là ne dissipera pas, et qui s’épanouira plus tard dans l’affaire des poisons. Le venin des perfidies est aussi très en usage chez ces courtisans dont l’appétit de privilèges excite les rivalités et les vengeances entre coteries.
Le monde où Atys va apparaître est en réalité âpre et cruel mais aspire à la douceur et à la tendresse du rêve. La mode est à une certaine dissolution des contours et des cadres, à une vapeur mouvante masquant l’envers du décor, qu’on ne saurait voir. La morale n’y échappe pas, vague souci des apparences sur lesquelles on feint encore de jeter le mouchoir de Tartuffe. La galanterie se trouve une parure dans le goût pour l’idylle, qui concilie les séductions de la fleurette et les charmes du bosquet. En musique et en peinture, les pastorales font écho au goût ambiant pour les « séjours » champêtres et les « tendres parterres » d’une nature volontiers idéalisée et déifiée.
OPÉRA SÉRIEUX ET THÉẬTRE DE LA CRUAUTÉ
Lully et Quinault vont faire fond sur ce mélange de sombres rivalités, de tendres sentiments et de rêveries bucoliques pour déployer leur nouvelle tragédie lyrique et franchir un cap dans la mise en scène d’un « vrai tragique ». Car on ne rit plus, dans Atys. On soupire, on s’afflige, on languit, mais aussi, comme dans la tragédie au théâtre, on pleure et on meurt. C’est une ambition nouvelle, à ce point en tout cas, sans doute portée par Quinault principalement, qui s’appuie sur un texte très écrit et construit dont la finalité est d’émouvoir, jusqu’au saisissement. La particularité d’Atys, parmi les tragédies lyriques (et qui restera d’ailleurs assez singulière dans la production de Lully et Quinault) est d’entremêler la musique, le chant et la danse à une création littéraire qui regarde vers la tragédie classique comme l’entendent Corneille et Racine, et qui garde, au sein même du mélange inhérent au genre, un en-soi qui surprend. Cet insolite confère à Atys tout l’intérêt d’une expérience quasi unique : l’introduction de certains canons classiques dans cette bulle toute de baroque qu’est la tragédie lyrique dans son temps. C’est peut-être la création qui se rapproche le plus de ce qu’aurait pu être, en France, une tragédie mise en musique.
Plus qu’ailleurs dans son œuvre, Quinault montre ici un souci marqué de progression dramatique. Rien de « tragique » en apparence aux premier et deuxième actes. Des sentiments amoureux croisés, contrariés par des obstacles et des conflits, mais beaucoup d’innocence encore, qui laisse espérer des rebondissements guidés par une main bienveillante, et au final l’apaisement des tensions dans un dénouement heureux – comme dans les trois quarts des productions de Quinault. Il n’en sera rien. Atys est une tragédie qui a l’amour pour sujet et la mort pour issue. Toute sa construction est réglée comme un mouvement d’horlogerie, et son déroulement est inexorable comme une machine infernale. Quinault pousse l’habileté d’auteur jusqu’à nous donner assez tôt un indice que nous négligeons : l’importance du couteau sacrificiel, qui déjà annonce « l’arme du crime » si chère aux feuilletonistes à venir, bien qu’elle fasse partie de l’arsenal traditionnel de la tragédie. Cet intérêt pour l’intrigue, l’effet, l’effroi, font de Quinault un auteur moderne en son temps, et son approche de la tragédie, dans Atys, évoque curieusement aujourd’hui un autre genre, qui passionnera le public bien des générations après, le drame. Il y a chez lui cette même volonté de tenir en haleine, de surprendre, de terrifier, un certain goût pour l’implacable qui durcit par degrés le ton d’un spectacle dont les aimables moires vont soudain se charger de sang.
Le plus étonnant dans cet Atys signé Quinault, c’est sa troublante ambivalence de machine à rêver et de machine à tuer. Les charmes de la première sont si beaux, si doux, si enveloppants, que la brutalité de la seconde nous cueille en pleine rêverie pour nous jeter dans le prétoire d’une cour inique. Le changement de décor est violent et le sentiment d’injustice criant. On ne s’attendait pas à un verdict aussi sévère, à ce que la cruauté l’emporte sur l’amour, l’âge sur la jeunesse, et la reprise de contact avec la réalité est rude.
C’est bien, pourtant, l’effet recherché : créer une suite d’émotions qui transportent le spectateur, une variété de sentiments contradictoires qui dissout entièrement les frontières du réel et de l’imaginaire, et crée une illusion proche de la transe.
Pour cela, Quinault peut s’appuyer en confiance sur Lully. Lui seul, donnant à son talent des moyens illimités, est en mesure d’apporter ce mélange de vibrations chatoyantes, de grâces hypnotiques et de puissance lyrique qui assureront au spectacle son caractère proprement envoûtant.
Lecerf de la Viéville nous a rapporté les habitudes de travail de Quinault et Lully. Pour « le corps de l’opéra », la priorité allait à Quinault, qui écrivait « les paroles » sur lesquelles Lully composait sa musique. Mais pour les « divertissements », Lully créait en premier « les airs » avec des vers de son cru « dont le mérite principal était de quadrer en perfection à la musique » et Quinault « ajustoit les siens dessus ».*
Atys, avec sa versification souple qui préfère la sonorité de la rime à la régularité métrique, est un modèle de texte musical, non pas asservi à la musique mais composant avec elle une délicieuse harmonie. Certains passages deviendront vite populaires – au sens large, puisque le roi lui-même les chante volontiers ou les « place » dans la conversation, preuve qu’ils sont dans toutes les têtes. D’ailleurs, cette mémoire collective ne se limite pas aux mots ou aux airs : les contemporains reviennent fréquemment sur l’intermède du sommeil d’Atys, inoubliable merveille qui a d’emblée rencontré la faveur et même la ferveur du public, Mme de Sévigné en tête. Sa beauté, d’une magie presque surnaturelle justement, émane du prodigieux « ballet » qui lie les mots, les sons, les gestes et les déplacements. Il y a quelque chose d’intensément dansant – hors la danse elle-même – dans cet intermède qui demeure un sommet de la conjonction des arts.
Dans Atys, la danse est, comme toujours, à la place « naturelle » que lui assigne l’action, c’est-à-dire aux moments et aux lieux où elle constitue une activité justifiée par les circonstances : réjouissances populaires, cérémonies, fêtes pour accueillir une arrivée importante, divertissement donné en l’honneur d’un grand personnage.
L’intermède du sommeil d’Atys fait à cet égard un peu exception, mais cet hybride est emblématique de la véritable place de la danse dans la tragédie lyrique, c’est-à-dire au cœur même d’un spectacle qui met les trois arts sur un plan d’égalité. Il n’y a pas, sur ce point, de différence essentielle entre les comédies-ballet de Lully et ses tragédies lyriques. Faute de documents précis, il est difficile de décider si Pierre Beauchamps a signé les chorégraphies d’Atys, où dansent aussi Pécour et d’Olivet, et surtout de les connaître. Mais il est certain, en revanche, qu’outre les parties dansées proprement dites, toutes les scènes d’Atys sont intimement imprégnées des rythmes de la danse.
L’abbé Dubos l’indique nettement : Lully est très sévère quant à la parfaite exécution, au geste près, de ce que l’abbé appelle jeu muet, interprété par un demi-chœur, dont il a noté la présence déjà dans Psyché, Alceste et Thésée : « J’entends parler de ces ballets presque sans pas de danse, mais composés de gestes, de démonstrations, en un mot d’un jeu muet, que Lully avait placés dans (…) le quatrième acte d’Atys (…) »*. Dubos précise en outre que c’est d’Olivet qui a réglé le ballet des songes funestes, et Antoine de Leris confirme que le pantomime « se joignit à Beauchamps pour la composition des ballets cet opéra ». Ce qui incite à imaginer plusieurs chorégraphes œuvrant en commun, sans doute sous l’œil de Lully lui-même, dans un esprit de concertation qui se construit, se rode et se perfectionne à mesure, comme tous les rouages de ces pièces à machines.
TRAGEDIE D’AMOUR
Marmontel louait la simplicité des plans de Quinault, dont les situations, aisément nouées et dénouées disait-il, pouvaient s’exposer « en deux mots ». On hésite à s’y risquer sans son talent, pour résumer les tourments éprouvés par les protagonistes d’Atys, et surtout pour rendre compte de sa tonalité profondément élégiaque.
Au premier acte, l’indifférent Atys aime en secret la nymphe Sangaride, qui le chérit sans le lui dire. Elle est promise à Célénus, roi de Phrygie, et la déesse Cybèle assistera au mariage. Atys et Sangaride s’avouent leur attirance et se désolent.
Au deuxième acte, Cybèle doit choisir son Sacrificateur et Célénus attend cet honneur. Mais il échoit à Atys, doublement élu par la déesse, qui a décidé de lui révéler, en le plongeant dans le sommeil, le doux sentiment dont elle va lui faire don.
Au début du troisième acte, qui est celui de la mise en tension des ressorts dramatiques, Atys apprend en songe l’amour de Cybèle. Tandis que les songes agréables lui prédisent les plus grandes félicités, les songes funestes l’avertissent des dangers d’une infidélité, déjà évoquée par les premiers dans leur splendide chœur :
« Mais, n’oublie pas,
Que la beauté,
Quand elle est immortelle,
Demande la fidélité
D’une amour éternelle… »
Puis la déesse se déclare, ignorant les sentiments d’Atys. Sans avouer qu’il est épris de Sangaride, Atys s’incline, mais s’interroge sur un honneur importun qui crée un triple conflit entre la loyauté qu’il doit à son amour, à son roi et à la déesse. C’est le choix de Corneille dans la soie de Quinault :
« Que servent les faveurs que nous fait la fortune
Quand l’amour nous rend malheureux ?
Je pers l’unique bien qui peut combler mes voeux,
Et tout autre bien m’importune. »
Sangaride, qui ne sait rien du penchant de Cybèle, survient avec le désir de se confier à la déesse. Atys l’interrompt promptement, expliquant à Cybèle que la nymphe implore son soutien contre le projet du roi. Cybèle promet, et instruit ingénument Sangaride de son infortune. La prudente froideur que garde alors l’intéressé blesse les deux femmes. Le soupçon naît dans le cœur de Cybèle, qui exprime par une poignante élégie sa crainte d’être trompée.
« Espoir si cher, et si doux,
Ah ! Pourquoy me trompez-vous ?
Des suprêmes grandeurs vous m’avez fait descendre,
Mille coeurs m’adoroient, je les neglige tous,
Je n’en demande qu’un, il a peine à se rendre ;
Je ne sens que chagrins, et que soupçons jaloux ;
Est-ce le sort charmant que je devois attendre ?
Espoir si cher, et si doux,
Ah ! Pourquoy me trompez-vous ?
Helas ! Par tant d’attraits falloit-il me surprendre ?
Heureuse, si toûjours j’avois pû m’en deffendre !
L’amour qui me flattoit me cachoit son couroux :
C’est donc pour me fraper des plus funestes coups,
Que le cruel amour m’a fait un coeur si tendre ?
Espoir si cher, et si doux,
Ah ! Pourquoy me trompez-vous ? »
Dès la fin de cet acte et au suivant, le ton change. Le temps de l’innocence est fini et celui de la clémence ne viendra pas. C’est ici que Quinault surprend, et innove, en dirigeant résolument vers le bas le pouce du vae victis, ce qui va infléchir le cours de l’œuvre vers la note sombre qui la caractérise. Le défaut de soumission envers la déesse est un crime de lèse-majesté. Une faute qui exclut le pardon et appelle le châtiment. L’orage ne fait encore que s’annoncer, mais on sent déjà qu’il abrite le tonnerre des dieux, gros des flammes de la colère et des flèches de la vengeance.
Le quatrième acte apporte un faux calme : de dépit, Sangaride a accepté l’amour du roi. Atys dissimule sa passion. Après un éclaircissement avec Sangaride,
« Beauté trop cruelle, c’est vous,
Amant infidelle, c’est vous,
Qui rompez des liens si doux »
,
Atys se résout à trahir son roi et prétend que Cybèle s’oppose à l’hymen, alors que Sangar, père de Sangaride, donne une somptueuse fête fluviale. Les zéphyrs complices enlèvent opportunément les deux amants dans les cieux.
Au cinquième acte, c’est le déchaînement : Cybèle a découvert la trahison. Elle la révèle à Célénus et décide de punir les coupables, qui défendent bravement leur amour :
« Pouvez-vous condamner
L’amour qui nous anime ?
Si c’est un crime,
Quel crime est plus à pardonner ? »
La colère de Cybèle s’abat alors sur Atys, la furie Alecton « sort des royaumes sombres et inspire au cœur d’Atys sa barbare fureur » ; croyant frapper un monstre, il tue Sangaride avec le couteau du sacrifice, puis se tue. Avant de mourir, il peut encore lancer à la déesse (et à qui d’autre ?) cette adresse prométhéenne :
« Ô dieux ! Injustes dieux ! Que n’estes-vous mortels ?
Faut-il que pour vous seuls vous gardiez la vengeance ?
C’est trop, c’est trop souffrir leur cruelle puissance,
Chassons-les d’icy bas, renversons leurs autels. »
Puis, lorsque Cybèle veut faire enlever le corps de la nymphe, encore cette flèche du Parthe, d’une sincérité puissamment assassine et d’une réelle grandeur tragique, plus racinienne cette fois :
« Ah ! Ne m’arrachez pas
Ce qui reste de tant d’appas :
En fussiez-vous jalouse encore,
Il faut que je l’adore
Jusques dans l’horreur du trépas. »
L’exécution de la justice divine a apaisé la foudre mais laissé un goût de cendres. Désespérée, Cybèle s’afflige de la cruauté de sa vengeance. Elle redonne vie à Atys sous la forme d’un pin, l’arbre qu’elle aime, et demande aux divinités des bois et aux nymphes des eaux de le vénérer.
« Cybele, et le choeur des divinitez des bois, et des eaux » :
« Que cet arbre sacré soit révéré de toute la nature.
Qu’il s’esleve au dessus des arbres les plus beaux :
Qu’il soit voisin des cieux, qu’il règne sur les eaux ;
Qu’il ne puisse brûler que d’une flame pure.
Que cet arbre sacré soit révéré de toute la nature.
Que ses rameaux soient toûjours verds :
Que les plus rigoureux hyvers
Ne leur fassent jamais d’injure,
Que cet arbre sacré soit révéré de toute la nature. »
Toutefois, la déesse entend que la colère divine soit entendue de tous, et que nul n’en ignore :
« Cybele, et le choeur des corybantes » :
« Que le malheur d’ Atys afflige tout le monde.
Que tout sente, icy bas,
L’horreur d’un si cruel trépas.
Pénétrons tous les coeurs d’une douleur profonde :
Que les bois, que les eaux, perdent tous leurs appas.
Que le tonnerre nous responde :
Que la terre fremisse, et tremble sous nos pas.
Que le malheur d’Atys afflige tout le monde.
Que tout sente, icy bas,
L’horreur d’un si cruel trépas. »
C’est sur cet avertissement, promulgué aux quatre coins du royaume à grand renfort de chœurs, que s’achève la tragédie. Elle a fait beaucoup de morts. Dans cette zone sinistrée que vient de créer la fureur de la déesse, gisent l’amour, l’innocence, la joie et la Nature elle-même. Car Cybèle ne s’est pas épargnée, et le chagrin qui la dévaste désole aussi son œuvre, sa mission, sa raison d’être : ensemencer généreusement la terre et protéger ses fruits. Pourtant, par la musique, le chant, la danse, l’idée renaît peu à peu que la nature va reprendre ses droits et que la vie va refleurir.
MYSTÈRES INÉPUISABLES DE LA NATURE SOUVERAINE
La nature est la déesse éternelle des productions de Lully et Quinault. C’est une précieuse pourvoyeuse de sujets – le recours à la mythologie aidant – pour des courtisans habiles, et de décors pour des machinistes épris de féerie. Il est patent, aussi, que le roi aime la nature, domptée à Versailles, libre et sauvage à la chasse, bientôt simplement champêtre dans le refuge de Marly. Mais surtout, elle représente pour ces créateurs d’artifices la vérité du monde. La nature ne ment pas, ses lois régissent tout, ordonnent tout, dans les deux sens du mot. Il faut s’y soumettre, quitte à supporter ses caprices et ses brusques accès de fureur, parce qu’elle régénère la vie en permanence et, surtout, parce qu’elle est, en toutes ses composantes, le parangon même de la beauté et de l’harmonie. Quinault et Lully partagent entièrement cette vision, non seulement esthétique mais philosophique, d’une nature constituant l’ordre supérieur du monde, d’essence divine et sacrée, et que tout leur art vise à toucher. Leur poièsis a pour finalité la poésie.
Leur approche est du reste respectueuse. Même si l’on peut leur prêter une ambition un peu altière de grands prêtres, instruits de secrets que le commun des mortels ignore, et une curiosité audacieuse de voleurs de feu, on voit aussi clairement qu’à leurs yeux l’homme est l’humble sujet de la nature, dont les mystères le dépassent quoi qu’il fasse pour les interroger.
C’est encore l’intermède du sommeil d’Atys, avec son étrange et puissante alchimie, qui nous révèle le mieux la condition de l’homme au cœur de la nature selon Quinault et Lully. Combinant toutes leurs ressources au service d’une poésie onirique et d’une esthétique de l’hypnose, ils parviennent à créer un instant véritablement magique, suspendu, animé d’un subtil, léger et incessant bercement, une circulation qui est le mouvement intime de la nature dans l’homme – tel l’amour des cordes sympathiques – et qui demeure la clef du songe, ce qu’ont si magnifiquement compris et restitué Francine Lancelot et Brigitte Massin.
Thierry Leroux
Mai 2011