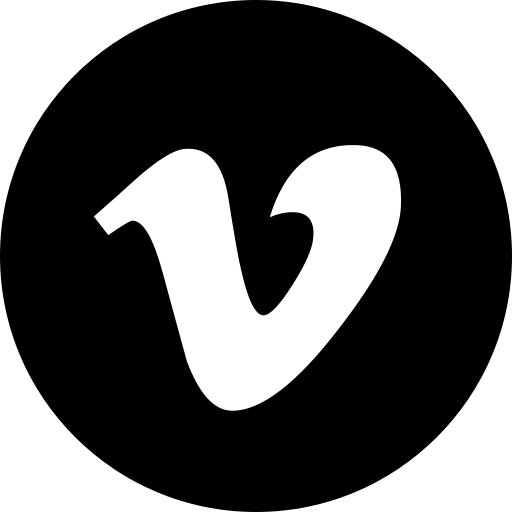Dans ce second volume, Cultures de l’oubli et citation, les danses d’après, II, j’observe en revanche la manière dont on reprend des œuvres dites modernes qui n’ont pas été destinées à être transmises de corps en corps, ni à être soumises à variation (comme dans le ballet dont la dynamique essentielle repose sur un principe de variation) ou à être recyclées (c’est le cas du répertoire ou du « matériel » chorégraphique de Merce Cunningham). Comment la mémoire d’une œuvre peut-elle persister alors qu’il y a crise ou rupture volontaire dans la transmission ? Les « danses d’après » dans ce cas, ce sont les danses d’après la crise générale de la culture au tournant des XIXe-XXe siècles en Europe, la révolution industrielle, la Première puis la Seconde Guerre mondiale – d’après les catastrophes –, mais aussi d’après la colonisation, où la continuité des traditions est mise à l’épreuve, voire devient impossible. Le point de départ, c’était tous ces projets chorégraphiques contemporains, dans les années 2000, qui procédaient de la reprise de gestes passés, via notamment le cinéma, la copie ou l’incorporation d’images d’archives. Je trouvais très intrigant qu’on puisse reprendre de manière très intense une œuvre qui avait été oubliée ou avait disparu, ou encore qui résistait à la transmission. À partir de peu de documents, on produisait des pièces qui faisaient circuler à nouveau des œuvres, avec un tout autre sens et une belle virulence. Qu’est-ce qui était si intense dans ces passés chorégraphiques au point de nous parler encore aujourd’hui ? Et à quelles conditions était-ce possible ?